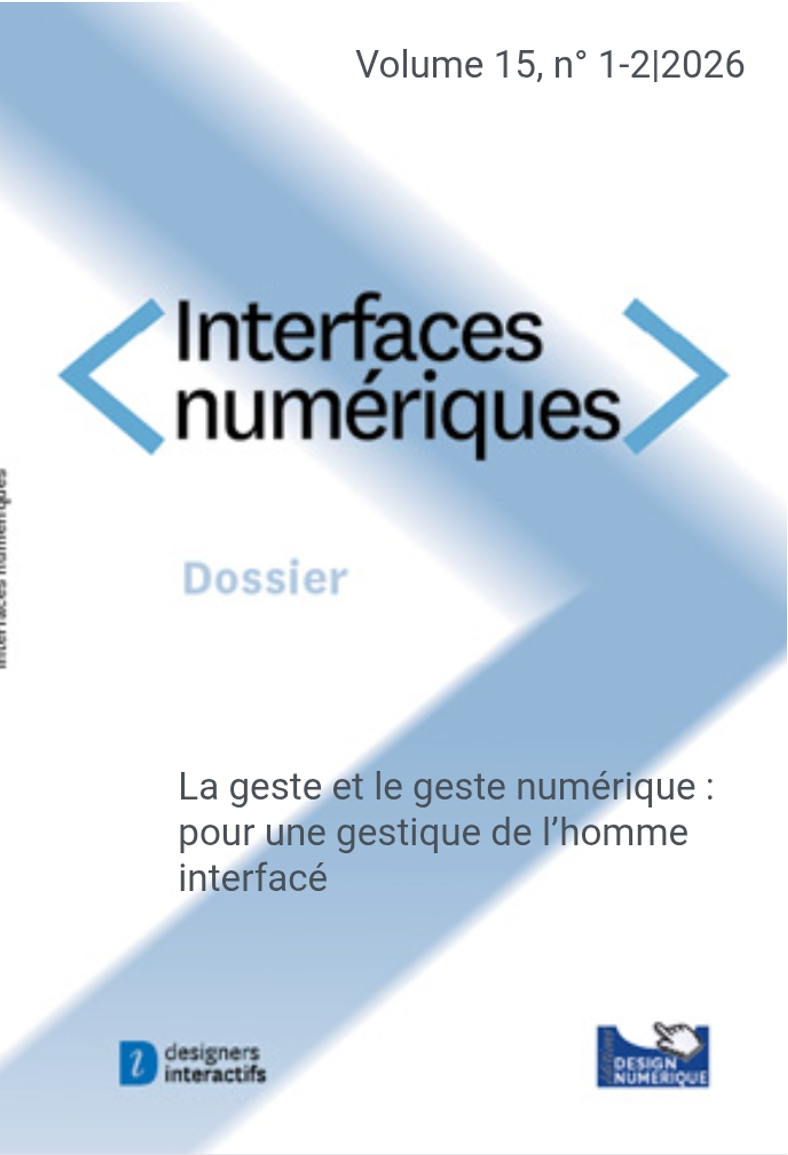AAC Volume 15, n° 1 et n° 2 |2026
La geste et le geste numériques : pour une gestique de l’homme interfacé
Numéro dirigé par i (Institut catholique de Paris),
(Université Le Havre Normandie)
et Marine Siguier (Université Le Havre Normandie)
Sortie du numéro en mai 2026
Date limite de réception des propositions : 10 décembre 2025
Contexte
A partir du constat d’une société toujours plus automatique (Stiegler, 2015), dont les avantages et les promesses se voudraient éclairés par la rhétorique techno-enthousiaste du solutionnisme du clic (Morozov, 2013), qui entraîne la naturalisation d’interfaces toujours plus « simples » et « intuitives » (Vitali-Rosati, 2024), le groupe de recherches interdisciplinaires InterGestes[1], à l’origine de cette proposition éditoriale, vise le questionnement du jumelage endogène de la geste et du geste à l'aune des productions numériques. Cette association thématique motive les travaux de recherche du groupe depuis 2023. D’abord une intuition lexicale, elle a reçu les premiers jalons conceptuels à la faveur d’une journée d'étude inaugurale, qui a elle-même donné lieu à l'organisation et à l’animation d’ateliers internes au réseau naissant. Les travaux se sont poursuivis avec deux cycles de webinaires Dialogues scientifiques et un premier colloque international, La geste et le geste numériques, (25-26 juin 2025, Université Le Havre Normandie), qui ont accueilli des contributions originales, fortement ancrées dans l’interdisciplinarité : sciences de l’information et de la communication, philosophie, sémiotique, sociologie, archéologie des médias, esthétique, études littéraires.
Le couplage la/le geste numériques, ambitionne de mettre en exergue la nature de la panoplie gestuelle et ses impacts dans les littératies contemporaines et les imaginaires de la technologie numérique, produits à la fois par la geste en tant qu’expression de l’“histoire glorifiante d’un peuple, d’un groupe social, d’un individu”[2]ainsi que par le geste, au sens de la gesticulation, du tracé, de la manœuvre, de l’action ou de la conduite d’action. Tout geste est un geste d’appareil (Leroi-Gourhan, 1965), un acte efficace et traditionnel, embrassant à la fois les techniques du corps (Mauss, 1936), l’emploi des instruments les plus sophistiqués et que l’informatisation et la simulation de nos “gestes mentaux” (Citton, 2012).
Si le geste est d’abord une manière de prendre position dans une situation (Goetze, 2011), force est de constater qu’avec les gestes et les micro-gestes quotidiens de la culture numérique (Doueihi, 2013), nous incarnons et accueillons un ensemble évolutif de postures et des attitudes, des mouvements et des réflexes, qui façonne aujourd’hui autant de rituels (Nova, 2022), jusqu’aux nouvelles façons de marcher dans la rue, les yeux rivés sur un écran (Cavallari, 2017, 2021). Nous sommes dans le monde sous la forme des gestes (Flusser, 1999), c’est par le geste que nous appartenons au monde (Jousse, 1974).
Le mode des usages numériques se caractérise par la miniaturisation et l’invisibilisation de gestes toujours moins réfléchis car accélérés, automatisés, pilotés par une technologie réactive, douée d'une certaine forme de sensibilité. On la croit capable d’interpréter, voire d’anticiper. Elle oriente les choix et les actes qui s’accomplissent d’abord en tant que gestes (Sadin, 2015). La gestique de l’homme interfacé semble comporter le risque de la banalisation et de l’uniformisation de nos gestes ordinaires, au nom de la simplification popularisée et glorifiée par le discours techno-enthousiaste des GAFAM, qui nous poussent à déléguer, de façon a-critique et insouciante. Avant que le discours des GAFAM ne devienne la seule gesta socio-technologique de notre époque, nous sollicitons d’autres narrations possibles, d’autres hypothèses, afin d'écrire une nouvelle mythologie des pratiques numériques critique et vigilante. Si interroger le geste revient toujours à interroger notre être-au-monde et nos formes de vie (Macé, 2017), le questionnement que nous visons ici nous apparaît urgent à l’aune de la transformation de nos gestes quotidiens en tant que gestes d’interface et d’écran.
Argument
En prenant l’étymologie pour force de preuve, on situe l’idée racine : tout geste incorpore une geste. La geste dérive du latin gesta, du verbe gerere, qui signifie agir, faire. En ancien français, le mot désigne le récit des actions mémorables et hauts faits d’un héros et de ses représentants ; la geste médiévale se fait alors trace car il s’agit de garder en mémoire ces actes héroïques. La geste est le fait du mouvement par sa nature propre : diégétique, inscrite dans l’axe espace-temps, y compris quand elle accueille du geste, elle historicise, elle met en parole, s’emploie à dérouler, faits, chroniques et aventures. Le geste, quant à lui, est issu du latin gestus, désignant une attitude, un mouvement du corps, un jeu, une mimique de l’orateur ou de l’acteur. Nous postulons que le geste, dans sa déclinaison digitale, réinvente la geste, dans son acception médiévale, par le fait de raconter et de se raconter, par la mise en scène de soi sur les réseaux et les plateformes (Aubert & Haroche, 2011 ; Georges, 2009 ; Siguier, 2025 ; Stiegler, 2012) qui, à leur tour, transforment les gestes liés aux histoires écrites, lues et éditées.
La mise en avant de l’ancrage cinétique qui fonde le couplage la/le geste favorise la diversité des regards, des approches et des hypothèses. Déployer des gestes, c’est impliquer le corps, c’est exiger ses aptitudes et ses expériences, que ce soit pour démarrer, pour appuyer, glisser, transférer, télécharger, etc. L’interaction ne se déploie pas seulement à un niveau rationnel, elle s'accomplit aussi comme une expérience sensorielle et sensible. Quelle que soit la puissance du design des “boutons” – menu, navigation, applications -, il n’est pas d’exploration, pas d’agir digital sans les mains, sans le regard, sans le souffle, voire sans la voix (les commandes vocales, Google voice, Siri, Bixby, Cortana). Souvent dévalorisé dans les discours politiques et économiques, le clic doit être questionné dans ses implications individuelles et collectives (Casilli, 2019), d’autant que le swipe fait, lui, désormais l’objet d’une naturalisation qui contraint notre liberté et notre vision du monde (Garmon, 2018).
On le voit, les gestes d’interface constituent une “modalité”, soit un ensemble de règles spécifiques, de significations et de formes plus ou moins iconiques. De même, chaque interaction gestuelle est motivée par un système de valeurs et par un “mode d'être propre à l’objet, et qui peut être source de plaisir et déplaisir (Pignier, 2012). Aussi, face à la banalité du mimétisme du geste digital, au cœur de la communication géminée (Dula, 2015, 2016, 2021) qui double, réplique et répète à l'envi ses propres gestes, il est toujours pertinent de dresser un inventaire des segments somatiques ou fonctionnels, voire organiques, qui irriguent le règne digital. On peut s’autoriser, par-là, une critique des narrativités gestuelles informatisées, afin d’esquisser, à nouveaux frais, une anthropologie du geste, ou de l’élargir en l’amendant.
Attendus, finalités
Pour mener cette entreprise, on accueillera entre autres des enquêtes situées dans les pratiques informatisées qui prennent appui dans (au moins) un dispositif archétypal, afin de circonscrire des principes techno-progressistes à l’œuvre. Les auteurs seront invités à interroger la geste et/ou le geste à l’aune du digital et proposeront de replacer la caractérisation numérique des termes dans des contextes multiples, historique, technique, culturel et social, communicationnel, clinique, etc. Ce faisant, les contributions mettront en lumière des usages contemporains et leurs enjeux sur la culture et la communication des sociétés.
Le geste numérique se révèle enraciné dans une archéologie immensément vaste, qui inclut à la fois les techniques d’expression ancestrales, la chanson de geste médiévale, et le swipe des écrans tactiles. Cet appel à contributions invite à poursuivre les explorations, de façon à historiciser le concept de geste et à l’éclairer à l’aune des problématisations suscitées par l’objectivation, la simulation et la programmation des réactions propres aux dispositifs informatisés. L’historicisation du geste interfacé peut bénéficier de l’approche de l’archéologie des médias, qui nous permet de reconnaître des lignes de continuité et de rupture tout au long de l’histoire de la technologie, notamment des technologies de l’enregistrement de la voix (Ethuin, 2025). Ces histoires sont marquées par quelques échecs prophétiques, en particulier dans les technologies de la communication (Acland, 2007 ; Cavallari, 2016), en dépit de tout déterminisme ou finalisme technologique.
Liste non exhaustive des axes envisageables :
Les gestes numériques engagent des pratiques d’écriture, de lecture et d’écoute (Cavallari & Mellet, dir., 2025) qui s’en trouvent à la fois prolongées et renouvelées. Ainsi, de la machine à écrire au smartphone en passant par l’ordinateur, les outils techniques implémentent des gestes de la main séculaires, de même qu’ils rejouent des inégalités entre les genres et les sexes : ainsi, les premiers assistants virtuels comme Alexa sont des figures féminines (Dula, 2015 ; Mellet, 2022). De la même manière, les phénomènes de naturalisation du numérique et de l’IA font écho aux processus de naturalisation sociale déjà à l'œuvre au XIXe siècle (Roth, 2022). Il s’agira alors d’interroger la geste derrière les gestes des internautes : quels discours, quels récits, quelles valeurs sous-tendent cette double posture, entre volonté de distinction et standardisation communautaire (Siguier, 2025).
Dans une double perspective, phénoménologique (Merleau-Ponty, 1945 ; Sartre, 1943) et neurophysiologique (Berthoz, 2013), les perceptions ne sont que des anticipations des gestes, qui, de ce fait, se comportent comme des actes perceptifs et affectifs, au sens des “affects numériques” aussi (Allard, Alloing, Le Bechec, Pierre, 2016). La théorie externaliste et de la cognition incarnée (Varela et al., 1993) et les recherches de Martin-Juchat (2008, 2014) et Lenay (2015) montrent comment les émotions et l’empathie se produisent dans l’espace relationnel, corporel et gestuel. Notre corps habite un espace polytopique (Stock, 2011), dans lequel la performance d’écran réalise, dans le cadre et hors-cadre, la coexistence entre plateformes et interfaces numériques et les lieux connectés au réseau où nous nous trouvons. Un geste numérique, un geste d’orientation et de recherche, d’écriture ou de lecture, de visionnage ou de partage, est toujours un événement qui a lieu, au même moment, dans l’interface numérique et là où nous nous trouvons : ici les deux espaces fusionnent dans une spatialité créée et régie par le même mouvement (Cavallari, 2020, 2021). Si les notions de “signe-trace” et de “corps-trace” (Galinon-Mélénec, 2020, Galinon-Mélénec et al., 2019) actualisent les questions propres à une phénoménologie des gestes, elles posent néanmoins la question de la reconnaissance et de la compréhension des gestes d’autrui comme étant la condition préliminaire de l’humanité des gestes (Flusser).
La gestique des robots humanoïdes interroge la mise en fiction des corps via la robotisation. Les recherches interdisciplinaires engagées partent du constat que la robotique connectée tend à occuper l’espace public et relationnel quotidien, au point de se présenter comme un pivot des communications ordinaires. À la faveur des développements des technologies smartifiées (Dula, 2019), eux-mêmes portés par un capitalisme numérique attentionnel et affectif dont la force idéologique est désormais largement documentée, les robots compagnons œuvrent à la fabrication d’une mimesis transhumanisante (Besnier, 2009) et à la métamorphose radicale des représentations sociales et sociétales. Adossée aux robots compagnons, la gestique permet de cheminer vers la compréhension des processus d’anthropomorphisation qui les fondent (Tisseron, 2015), et par là des matérialités, des supports, des langues, des fonctionnalités etc., qui justifient les incorporations et les narrativités mises en exergue par les discours promotionnels. Cette perspective amène à observer, d’une part, les efforts des designs contemporains pour joindre le geste à la geste. D’autre part, elle rend possible la critique de l’émergence d’un imaginaire réifié et redistribué (Obadia, 2023,2025), particulièrement par les robots compagnons et les robots sexuels connectés (Bonenfant & Dula). Au cœur de cette perspective, les récits que ces designs et ces dispositifs produisent méritent d’être interrogés.
En tant que support et partenaire de nos gestes, l’écran constitue une interface démultipliée et omniprésente. Les gestes nouveaux induits par ces écrans sont associés à un ensemble de discours institutionnels préventifs, qui tendent parfois à présenter “le” numérique comme une entité autonome et menaçante. Les travaux des psychologues mettent en garde contre ce risque d’anthropomorphisation des technologies (Tisseron, 2022), qui escamote paradoxalement la dimension humaine et corporelle inhérente à ces dispositifs. Interroger le rapport émotionnel et “néo-animiste” (Juchat, 2022) aux écrans, c’est aussi mettre au jour des dynamiques de pouvoir qui se déploient depuis des années derrière le “travail du clic” (Casilli&Tubaro, 2023). Antonio Casilli (2019) propose ainsi une contre-histoire de l’IA, qui s’intéresse aux petites mains qui produisent les données, plutôt qu’à l’évolution des machines. À travers des prismes sociologique, historique et psychologique, la gestique numérique se dévoile dans toute son épaisseur symbolique et politique. Il s’agit aussi d’interroger les imaginaires liés aux écrans, et leurs évolutions historiques et contextuelles - qui expliquent par exemple qu’on n’associe pas du tout les mêmes valeurs, connotations et préconisations à un écran de smartphone qu’à un écran d’ordinateur.Références bibliographiques
Acland, Charles R., 2007, Residuals Media, Minnesota Press
Allard, L., Alloing, C., Le Béchec, M., Pierre, J., (dir.), « Émergences. Les affects numériques », Revue française des sciences de l’information et de la communication, 11|2026
Aubert, N., Haroche, C., (dir.), 2011, Les tyrannies de la visibilité, Paris, Eres
Berthoz, A., 2013, Le sens du mouvement, Paris, Odile Jacob
Besnier J-M., 2009, Demain les posthumains, Paris, Hachette.
Besson, Françoise Lavocat, François Lecercle, Contes, mondes et récits, CNRS Editions
Bonenfant M., Dula D., « L’imaginaire transhumaniste du développement technologique : le cas des robots compagnons et de l’autocare », dans Collectif, Les Imaginaires du développement technologique, une typologie, Paris, MkF éditions (à paraître)
Bruner, J., 2002, Pourquoi nous racontons-nous des histoires ?, trad.fr., Paris, Retz
Casilli A., 2019, En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic, Paris, Seuil.
Casilli A, Tubaro P., 2023, « Travail du clic, travail sans qualité ? », in Catherine Courtet, Catherine Courtet, Mireille Besson, Françoise Lavocat, François Lecercle. Contes, mondes et récits, CNRS Editions
Cavallari, P., 2021, « La performance d’écran. Gestes d’écriture, visage et image du corps », Etudes digitales, 2021-2 n° 12
Cavallari, P, 2020, « The Distance of the Presence. What does it men to Be online and offline with Others? », dans M. Treleani, V. Zucconi (dir.), Remediating Distances, img journal, Bologna, Alma Mater, pp. 120-135
Cavallari, P, 2017, « Les gestes dans l’environnement numérique : la ponctuation des affects », Revue française des sciences de l’information et de la communication, 11|2017
Cavallari, P., 2016, « Le Phonopostale et les sonorines : un échec riche d’idées », Cahier Louis-Lumière, 10.
Cavallari, P., & Mellet, M., 2025, (dir.), « Écouter (à) l’écran. Voix écrite et lecture conversationnelle, son, bruit et silence de la présence à distance », Terminal. Technologie de l'information, culture & société, 141|2025
Citton, Y., 2012, Gestes d’humanités. Anthropologie sauvage de nos expériences esthétiques, Paris, Armand Colin
Deneuville A., 2025, Copier-coller. Le tournant photographique de l’écriture numérique, Grenoble, UGA Editions.
Doueihi, M., 2013, Qu’est-ce que le numérique ?, Paris, PUF
Dula D., 2016, « Tous des copieurs ? La communication électronique à l'épreuve de la mimesis », dans Zlitni S. et Liénard F. (dirs), La Communication électronique en question, Peter Lang. ⟨hal-05146644⟩
Dula D., 2015, La Communication géminée. Mimesis et médias informatisés, thèse de doctorat, Université Le Havre Normandie. https://hal.science/view/index/docid/5168394
Dula D., 2021, « Le robot est-il un mème ? Trace, projection et mimétisme des objets compagnons », dans Boulekhbache H., Galinon-Mellenc B., Leleu-Merviel S. (dirs), L’Homme-trace. La trace, du sensible au social, Paris, CNRS Editions, pp. 301-317.
Ethuin, P., « Clicher/Tracer : le phonographe entre imaginaire photographique et scriptural (1878-1889) », Terminal, 141|2025
Flusser, V., 2014, Les gestes, Bruxelles, Al Dante
Galinon-Mélénec B., 2025, « Le concept du corps-trace comme ressource sémiotique pour une méthodologie interdisciplinaire », dans Bigliari A., La sémiotique et ses potentiels, Academia
Galinon-Mélénec, B., Zlitni, S., Liénard, F., 2019, L’homme-trace. Inscriptions-corporelles et techniques, Paris, CNRS
Galinon-Mélénec B., 2020, L’Odyssée de la trace, tome 1, Londres, Iste éditions
Garmon, I., 2018, « Le “swipe” pour se rencontrer ou la promesse d’une interaction « fluide » : Étude de cas d’un “petit geste” de manipulation des interfaces tactiles », Interfaces numériques, 7(1).
Georges, F., 2009, « Représentations de soi et identité numérique. Une approche sémiotique et quantitative de l'emprise culturelle du web 2.0.”, Réseaux : communication, technologie, société, 154 (2).
Goetz B., 2011, Théories des maisons, Lagrasse, Verdier
Jousse M., 1974, L'Anthropologie du geste, Paris, Gallimard.
Lefebvre, H., 1974, La production de l’espace, Paris, Anthropos
Lenay C., 2006, « Énaction, Externalisme et Suppléance Perceptive », Intellectica, 1, 43, pp. 27-52.
Lenay C., 2015, « “C’est très touchant”, La valeur émotionnelle du contact », dans Steiner P. et Stewart J., Philosophie, technologie et cognition, Intellectica, 53-54.
Leroi-Gourhan, A., 1965, Le geste et la parole,.Technique et langage, Paris, Albin Michel
Macé, M. (2017), Styles. Critique de nos formes de vie, Paris, Gallimard
Martin-Juchat, F. (2022), Sur le néo-animisme technologique à l’ère de l’engouement pour l’Intelligence Artificielle, dans Quaderni, 105, hiver 2021-2022
Martin Juchat, F., 2014, « Quel corps pour les Sciences de l’Information et de la Communication ? ». Les Cahiers de la SFSIC, n° 9
Martin-Juchat F., 2008, « Penser le corps affectif comme un média », Corps, 4(1), pp. 85-92. https://doi.org/10.3917/corp.004.0085
Mauss, M., 1936, 1950, Les techniques du corps, Paris, PUF
Mellet, M., 2022, « Les petites mains de l’édition : réflexions pour des environnements éditoriaux équitables, pluriels et inclusifs », dans A. Mahé, I. Mayeur, E. Poupardin et C. Prime-Claverie, Communication scientifique et science ouverte : Opportunités, tensions et paradoxes - Actes du colloque « Document numérique et société », Liège, De Boeck Supérieur, pp. 103-120. https://doi.org/10.3917/dbu.annai.2023.01.0103
Merleau-Ponty, M., 1945, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard
Morozov, E., 2013, To Save Everything, Click Here, PublicAffairs
Nova, N., 2022, En route vers le rituel, Techniques et cultures, 78|2022
Obadia L., 2023, « Photographier des robots en laboratoire : images, mouvement et contextes » , Civilisations, 72, 135-151
Obadia L., 2025, Le corps du robot humanoïde, de l’humain au-delà de l’humain ? Promesses, prouesses, projections et programmes, dans Lomo Myazhiom, A.C., (dir.), Corps, identité(s) et sociétés. vol. 2, Autour de David Le Breton, Editions Archives contemporaines
Pignier, N. (2012), Le plaisir de l’interaction entre l’usager et les objets TIC numériques, dans Interfaces Numériques, vol. 1 n° 1I 2012 https://doi.org/10.25965/interfaces-numeriques.74
Sadin, E. (2015), La via algorithmique, Paris, L’Echappée Sartre, J.-P., L'Être et le Néant, Paris, Gallimard
Siguier M., 2025, Des livres et des likes, Paris, Sorbonne Université Presses.
Stiegler, B. (dir.), 2012, Réseaux sociaux, Fyp, IRI
Stiegler, B., 2015, La société automatique, Paris, Fayard
Stock, M., 2011, « Habiter avec l’autre : identité et altérité dans le style d’habiter polytopique », dans Le sujet dans la cité, Paris, L’Harmattan, n° 2
Tisseron S., 2015, Le jour où mon robot m’aimera, vers l’empathie artificielle, Paris, Albin Michel.
Tisseron S., 2022, Vivre dans les nouveaux mondes virtuels. Concilier empathie et numérique, Paris, Dunod
Varela, F.J., Thompson, E., Roch, E., 1993, L’inscription corporelle de l’esprit : sciences cognitives et expérience humaine, Paris, Seuil
Vitali-Rosati M., 2024, Eloge du bug. Être libre à l’époque du numérique, Paris, La Découverte
Wulf, C., 2007, Une anthropologie historique et culturelle. Rituels, mimésis sociale et performativité, Paris, Téraèdre
Organisation scientifique
Les propositions seront envoyées par mail, dans un fichier au format rtf., docx. ou odt. Elles devront compter entre 4000 et 5000 caractères (espaces non compris). Étant donné les contraintes du calendrier, les propositions plus structurées et étoffées seront particulièrement appréciées.
Dans le même fichier, les auteurs écriront une courte biographie, en faisant référence à leurs titres scientifiques, à leurs derniers travaux ainsi qu’à la section CNU de rattachement.
Ce fichier devra être envoyé aux adresses suivantes :
p.cavallari@icp.fr
daiana.dula@univ-lehavre.fr
marine.siguier@univ-lehavre.frObjet : InterGestes 2026
Calendrier provisionnel
Envoi des propositions : date limite, 10 décembre 2025
Réponses aux auteurs : date limite, 23 janvier 2026
Remise des articles pour lecture en double aveugle (V1) et navette avec les auteurs ( V2) : dates limite, 13 mars 2026 (V1) et 30 avril 2026 (V2)
Mise en ligne du numéro 1/2026 : 18 mai 2026
Contacts : p.cavallari@icp.fr, daiana.dula@univ-lehavre.fr et marine.siguier@univ-lehavre.fr
Interfaces Numériques est une revue scientifique reconnue revue qualifiante en Sciences de l’Information et de la Communication sous la direction Nicole Pignier et de Benoît DrouillaT.
Présentation de la revue classée par l’HCERES (Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur) : https://www.unilim.fr/interfaces-numeriques/